
La tragédie sans alibi par Eddy d’arango au théâtre de l’Odéon
Il faut d’abord accepter d’être déplacé. Non pas uniquement ému – l’émotion est trop simple, trop disponible –, mais déplacé, désaxé, presque délogé de sa place confortable de spectateur venu se replonger dans un classique.
Car l’Œdipe Roi d’Eddy D’aranjo d’après Sophocle, présenté à l’Odéon, ne cherche pas à revisiter la tragédie. Il l’utilise comme une faille. Un point de rupture dans l’histoire du théâtre occidental, par lequel remonte, comme une eau noire, ce que la tragédie a toujours montré sans jamais vraiment le regarder : l’inceste, non comme mythe, mais comme système.
On pourrait croire à une énième relecture contemporaine d’un monument antique. Il n’en est rien. D’aranjo ne revisite pas Sophocle : il l’accuse. Ou plutôt, il s’accuse avec lui.
Défaire le silence
Il interroge ce paradoxe inaugural : dès la naissance du théâtre, l’inceste est là, partout, et pourtant introuvable. Mythe sublime, catastrophe symbolique, matière à catharsis – mais jamais crime social massif, jamais domination concrète, jamais silence organisé.
Ce spectacle est une enquête. Et le mot n’est pas galvaudé. Comme « Œdipe », le metteur en scène avance à tâtons vers une vérité qu’il pressent insoutenable. Mais ici, l’oracle est remplacé par les archives, les statistiques, les récits, les silences familiaux.
La peste qui ravage Thèbes prend la forme d’un chiffre : des centaines de milliers d’enfants concernés. Et l’aveuglement n’est plus une punition divine, mais un mécanisme social, presque administratif.
La force du spectacle tient à cette hybridation radicale : performance, documentaire, autobiographie, méditation philosophique, fragments tragiques. On navigue sans cesse entre l’intime et le structurel.
Le « je » n’est jamais complaisant ; il est mis en crise. D’aranjo se place dans une position dangereuse : ni victime héroïsée, ni analyste surplombant. Il pense devant nous. Il doute devant nous. Il creuse sa propre histoire familiale comme on ouvrirait un sol instable, sans garantie de trouver autre chose qu’un vertige supplémentaire.
Il y a quelque chose de profondément anti-spectaculaire dans cette démarche. Le théâtre de témoignage est convoqué, puis immédiatement interrogé. À quelles conditions un récit peut-il être entendu ? Quelles émotions faut-il exhiber pour être cru ?
La pitié et la terreur – affects tragiques par excellence – sont suspendus, presque disséqués. Le spectacle refuse la sidération facile. Il préfère le trouble.
Scéniquement, le travail de Clémence Delille et d’Edith Biscaro (scénographie, costumes, lumière) installe un espace à la fois clinique et fragile, où la parole semble constamment menacée de disparition.
La vidéo, loin d’illustrer, introduit un régime de regard. Voir, ici, n’est jamais neutre. Qui regarde ? Qui a le droit de voir ? Qui a confisqué le savoir sur les corps ?
Dans la dernière partie, consacrée à la figure de la grand-mère, le spectacle bascule vers une zone plus incertaine, presque onirique. Le portrait n’est jamais vériste.
Il est traversé par l’imaginaire, assumé comme tel. Et ce refus de combler les trous par de fausses certitudes. L’énigme demeure.
Cette femme, écrasée par un ordre patriarcal, tentant de divorcer d’un mari violent, pratiquant des avortements clandestins, devient une figure à la fois singulière et collective. Elle incarne moins une vérité biographique qu’un manque historique : celui des vies empêchées.
Il y a chez D’aranjo une tension constante entre tragédie et politique. La tragédie suppose une fatalité. Le politique suppose une transformation possible. Le spectacle tient précisément dans cet écart.
Il reconnaît la dimension abyssale de certaines violences – leur transmission, leur opacité, leur puissance de destruction – tout en refusant d’en faire un destin indépassable. Le réalisme revendiqué n’est pas celui de la simple description, mais celui des possibles non advenus ou réalisés malgré tout .
Et dans cette traversée, il faut voir les comédiens non comme d’interprètes au service d’un texte, mais comme de corps exposés à une pensée en train de se faire.
Edith Biscaro, Clémence Delille, Marie Depoorter, Carine Goron, Volodia Piotrovitch d’Orlik et Eddy D’aranjo lui-même ne composent pas des personnages au sens classique : ils occupent des positions instables, glissent du récit à l’analyse, de l’adresse frontale à l’incarnation fragile. Il y a chez eux une retenue presque dangereuse – rien d’hystérisé, rien de démonstratif.
La parole circule comme un matériau sensible, parfois sec, parfois vacillant. Volodia Piotrovitch d’Orlik porte une pensée qui se cherche, sans posture professorale, dans une forme d’honnêteté intellectuelle désarmante. Carine Goron, face à la figure énigmatique de Jeanne, travaille le flou, l’inachevé, laissant affleurer une présence plus qu’un portrait.
Marie Depoorter engage son corps avec une précision calme, sans spectaculaire, dans des gestes qui déplacent profondément le regard. Quant à D’aranjo, il ne s’abrite jamais derrière la mise en scène : il s’expose, sobrement, dans une tension contenue.
Tous partagent cette qualité rare : ne pas chercher à convaincre, mais à tenir, ensemble, dans une zone de vérité instable où le théâtre cesse d’être performance pour devenir épreuve.
On sort de la salle sans catharsis nette. Mais avec cette réflexion puissante de penser, de pouvoir encore apprendre à mieux regarder. Ne pas détourner les yeux. Comprendre que le silence n’est pas absence de parole, mais organisation active de l’oubli. Ce qui frappe, au fond, c’est la cohérence éthique du projet.
Le spectacle ne prétend pas réparer. Il ne promet pas de guérir. Il ne se donne pas comme solution. Il accepte sa faiblesse – celle du théâtre face aux structures matérielles de domination – tout en revendiquant sa puissance spécifique : celle de la pensée incarnée, de la beauté inquiète, de la vérité risquée.
« Œdipe », chez Sophocle, se crève les yeux pour ne plus voir l’horreur qu’il a découverte. Ici, le geste est inverse. Il s’agit d’ouvrir les yeux – même si cela brûle. Même si cela ne résout rien. Peut-être surtout pour cela.
Eddy D’aranjo signe ici une œuvre dense, exigeante, percutante, qui ne cherche ni l’unanimité ni le confort moral. Un théâtre qui ne se contente pas de représenter le monde, mais qui interroge les conditions mêmes de sa représentation.
Un théâtre qui rappelle, avec une gravité sans emphase, que certaines vérités ne détruisent pas seulement les héros tragiques : elles ébranlent des sociétés toutes entières.
Dates : du 7 au 22 février 2026 (3h40 avec un entracte) – Lieu : Berthier (Paris 17)
Texte et mise en scène : Eddy d’aranjo


![[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/03/9782017348276-001-x-218x150.webp)
![[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344064481-001-x-218x150.webp)
![[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344068458-001-x-218x150.webp)

![[Manga] Dragon Ball – Full Color – Les Saiyans – Tome 02, d’Akira Toriyama (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344074145-001-x-218x150.webp)

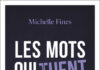

![[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/03/9782017348276-001-x-100x70.webp)

![[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344064481-001-x-100x70.webp)
![[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344068458-001-x-100x70.webp)

![[Manga] Eyeshield 21 – Brain Brave, de Riichirô Inagaki & Yûsuke Murata (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344071298-001-x-100x70.webp)


![[Manga] Dragon Ball – Full Color – Les Saiyans – Tome 02, d’Akira Toriyama (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344074145-001-x-100x70.webp)
![[Album jeunesse] Les belles photos de famille, de Siwon Lee (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782017371007-001-x-100x70.webp)