
« Duras-Platini » : cette rencontre là
Avec « Duras-PIatini », on ne cherche pas à comprendre pourquoi Marguerite Duras rencontre Michel Platini. On accepte qu’ils se soient déjà rencontrés, quelque part entre une phrase surréaliste et une surface de réparation.
Et ce postulat posé, elle devient affaire de rythme, de souffle, de présence. Barbara Chanut à la mise en scène, ne fabrique pas une confrontation, encore moins un dialogue illustratif.
Elle installe une tension douce, presque absurde : celle de deux mythologies françaises que tout oppose et que le théâtre force à cohabiter.
Duras, c’est la voix. Platini, le geste. L’une écrit contre le silence, l’autre jouait contre l’espace. Le spectacle se tient précisément là : dans cet interstice où la parole voudrait courir, et où le corps refuse de se taire.
La mise en scène ne tranche jamais. Elle observe. Elle laisse les corps dire ce que les mots ne savent plus formuler, et les mots échouer à dire ce que le corps, parfois, réussit sans le savoir.
Il y a quelque chose d’inattendu dans ce spectacle. Pas de reconstitution biographique, pas de nostalgie lourde, pas de révérence appuyée. La metteuse en scène travaille à hauteur d’homme, pas à hauteur de statue.
Une rencontre en terrain neutre
Les figures s’allègent, les icônes respirent, les légendes s’ignorent un peu. Duras n’est pas une écrivaine sacrée, Platini n’est pas un héros du stade. Ils deviennent matières, textures, fragments.
La scénographie, volontairement dépouillée, agit comme un terrain neutre et un espace de projection mentale. On y entend le bruit du temps qui passe, celui des phrases qui reviennent, celui des gestes qui se répètent jusqu’à devenir mémoire séculaire.
Le spectacle avance par touches, par glissements, par reprises. Comme un match sans score, ou un texte sans point final.
L’interprétation constitue l’un des points d’équilibre les plus justes de « Duras–Platini ». Les deux acteurs évitent soigneusement toute tentation d’imitation. Il ne s’agit jamais de ressemblance, encore moins de caricature, mais d’incarnation déplacée, habitée. Ils ne rejouent pas des figures connues : ils en explorent les traces.
Cyrielle Rayet travaille la parole comme une matière vivante, instable, traversée de silences. Sa voix semble chercher la phrase autant qu’elle la prononce, laissant apparaître les hésitations, les creux, les résistances du langage. Elle ne sacralise pas le texte : elle l’éprouve, le laisse respirer, lui donne une densité presque physique.
Face à elle, Neil-Adam Mohammedi construit son jeu à partir du corps. Une présence mesurée, précise, marquée par la mémoire du geste sportif. Même immobile, son corps raconte une discipline passée, une habitude du regard et de l’évaluation. La parole est juste, ancrée, comme si chaque mot devait d’abord traverser l’expérience.
Entre eux, aucune confrontation spectaculaire. La fluidité des échanges organise une coexistence attentive, faite d’écoute et de retenue. Leur jeu dans la durée, sans effet ni démonstration, donne au spectacle sa profondeur humaine. C’est dans cette sobriété partagée que « Duras–Platini » trouve sa justesse.
Et puis il y a ce qu’ils nous laissent : non pas une conclusion, mais un écho. La solitude du champion, l’obsession de l’écrivain, le renversement des rôles, l’ignorance assumée qui devient curiosité — tout cela persiste, comme une reprise après les arrêts de jeu où l’on refait le match dans sa tête.
« Duras-Platini » ne donne pas de réponses faciles. Il propose des pistes, des zones de friction, des raccourcis improbables entre deux mondes qu’on croyait séparés.
En un mot ? Une rencontre scénique audacieuse, qui nous rappelle que la scène est d’abord un espace où les mondes se heurtent pour mieux se révéler.
Dates : du 7 au 18 janvier 2026 – Lieu : Théâtre de la Reine Blanche (Paris)
Mise en scène : Barbara Chanut



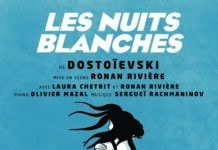



![[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/03/9782017348276-001-x-356x220.webp)
![[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/03/9782017348276-001-x-100x70.webp)

![[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344064481-001-x-100x70.webp)
![[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344068458-001-x-100x70.webp)

![[Manga] Eyeshield 21 – Brain Brave, de Riichirô Inagaki & Yûsuke Murata (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344071298-001-x-100x70.webp)


![[Manga] Dragon Ball – Full Color – Les Saiyans – Tome 02, d’Akira Toriyama (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344074145-001-x-100x70.webp)
![[Album jeunesse] Les belles photos de famille, de Siwon Lee (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782017371007-001-x-100x70.webp)

