
Gerhard Richter à la Fondation Vuitton : une genèse en perpétuel mouvement
Dès les premiers pas, l’exposition impose son rythme : une immersion dans la longue trajectoire de Gerhard Richter, couvrant plus de six décennies et 270 œuvres présentées.
Richter joue avec l’image — photographique d’abord, picturale ensuite, abstraite enfin — et l’exposition rend compte de cette oscillation permanente entre ce qui se voit et ce qui se devine. Dans ses œuvres photographiques peinte-floutée, il interroge la mémoire, la trace : tout est déjà décalé, tout est déjà souvenir.
Puis, il y a cette bascule vers l’abstraction, le geste matériel, le racloir, la superposition, et plus tard, les nuanciers, les « Strips », les jeux de couleur horizontale.
C’est un voyage qui donne le vertige : on n’a jamais la sensation d’un seul style immuable, mais d’un artiste en perpétuel dialogue avec lui-même, avec la peinture, avec l’histoire.
Certains tableaux font le pari du flou comme procédé, d’autres du raclage, de l’effacement partiel, de l’indication. Le spectateur est invité à devenir ce détecteur de traces, à accepter ce recommencement, à accepter que l’art est aussi incertitude.
Le labyrinthe du regard
Richter ne s’est pas contenté d’une ascèse formelle : son œuvre s’engage dans l’histoire, de manière souvent discrète mais imparable. On pense aux portraits de famille, aux souvenirs personnels, aux images agrandies extraites de journaux, aux séries gravées dans la mémoire collective.
Dans cette expo, on voit comment l’intime (un Onkel Rudi, une Tante Marianne) s’entrelace à l’Histoire (l’Allemagne, la guerre, le paysage social). Le propos ne se réduit jamais à un manifeste abstrait, il revient toujours à la vie, à la trace, à la question qu’est-ce que je vois et que je ne vois pas ?
L’accrochage joue sur les contrastes : des tableaux monumentaux, écrasants, imposent leur présence. Et à côté, des dessins de format réduit ou des études, effacées, presque confidentielles, invitent à une autre approche. Cette gestion du grand / petit, du spectaculaire / du discret, donne à l’exposition une respiration. On passe d’un champ visuel fort à un espace plus silencieux. Et c’est dans ces silences que l’on entend le « je » de Richter — l’artiste face à son médium, face à ses fantômes.
Le parcours rétrospectif commence donc par « Tisch », cette table peinte en 1962, image tirée d’un magazine, puis volontairement recouverte de gris.Ce geste inaugural — peindre pour effacer — contient déjà tout Richter. La toile, blessée, devient le laboratoire de ce que sera son œuvre : une lutte entre image et disparition, entre croyance et doute. L’artiste quitte la RDA, traverse la frontière, emporte avec lui le soupçon que toute image est mensonge. « Quand on peint, la pensée est peinture ». — Gerhard Richter.
Les années 1960 s’ouvrent sur les photo-peintures, ces portraits familiaux et historiques (Onkel Rudi, Tante Marianne), où la photographie est transposée à la main puis floutée. Le flou n’est pas un effet : c’est un principe moral, un refus de la netteté du monde. Le spectateur reconnaît une image, mais celle-ci se dérobe ; elle devient souvenir, remords, hantise. Dans ces toiles, Richter ne peint pas la mémoire : il peint le processus de l’oubli. Ce qu’il donne à voir n’est pas le passé, mais le tremblement de la vision elle-même.
À partir des années 1970, la couleur prend le dessus. Richter fabrique ses propres nuanciers, comme si la peinture devenait une science du hasard. Puis viennent les séries Abstraktes Bilder, peintures au racloir, coulées, effacées, reprises, où le geste mécanique se fait organique. Chaque raclage, chaque effacement est une respiration : ce n’est plus un tableau, c’est une strate de mémoire.
Au cœur de l’exposition, quatre toiles dominent la grande salle : la série Birkenau (2014).Elles furent peintes à partir de photographies clandestines prises dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Richter les reproduisit, les recouvrit, puis les fit disparaître sous des couches abstraites. Le résultat est bouleversant : une peinture sans image, où l’horreur ne s’efface pas mais s’absorbe.
L’exposition montre ici le courage du peintre : ne pas illustrer l’Histoire, mais la rendre indicible. Devant ces toiles monumentales, on se regarde presque soi-même : le reflet des vitres, les traces du corps du visiteur, deviennent partie de l’œuvre. La mémoire ne se montre plus, elle se réfléchit.
Dans les années 2000, Richter explore la transparence : les Glass Pieces, ces grandes plaques de verre superposées, renvoient la lumière, la diffractent, la fragmentent. Le spectateur passe d’une surface à l’autre, prisonnier d’un regard qui glisse. Puis viennent les Strip Paintings (2010) et les toiles quasi blanches, où la couleur se dissout jusqu’à n’être plus qu’un souffle. Ce ne sont pas des œuvres minimalistes, mais des palimpsestes : des paysages effacés par excès de matière. Sous le blanc, tout demeure : les couches, les gestes, les hésitations. On regarde un silence actif.
Depuis 2017, Richter a cessé de peindre à l’huile. Mais il n’a pas renoncé au geste. Ses dessins récents, exposés dans la dernière salle, prolongent cette idée d’une peinture qui s’est allégée jusqu’à devenir respiration. Crayons, encres, empreintes : les œuvres paraissent minuscules après les immenses abstractions, mais elles en sont le contre-chant. Elles ne disent plus « je montre », mais « je murmure ».
La scénographie de la Fondation, toute en transparence et en clair-obscur, accentue ce que l’exposition propose : non pas un panorama, mais une expérience du regard. Le parcours n’impose rien, il sollicite. On avance comme dans un labyrinthe de lumière, d’où émergent parfois des éclats de couleur, des zones de gris, des reflets de soi. Ce que l’on retient n’est pas tant un style qu’une attitude : la peinture comme doute organisé. Richter nous apprend que voir n’est jamais simple, que chaque image cache sa négation, que chaque couleur contient son silence.
L’exposition Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton est bien plus qu’une rétrospective : c’est un autoportrait mutant du regard. Un parcours où l’artiste, sans emphase, montre comment la peinture peut encore penser le monde, non en affirmant, mais en questionnant encore et toujours.
Dates : du 17 octobre 2025 au 02 mars 2026 – Lieu : Fondation Louis Vuitton (Paris)







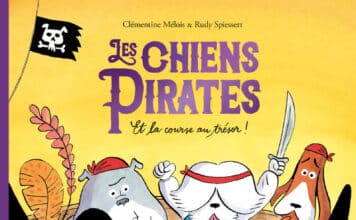






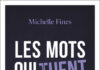

![[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/03/9782017348276-001-x-100x70.webp)

![[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344064481-001-x-100x70.webp)
![[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344068458-001-x-100x70.webp)