
“ Chère Madame Milena”. C’est par ces mots empreints de pudeur et de légère ironie que commence en avril mille neuf cent vingt l’une des plus intrigantes correspondances amoureuses de l’histoire des lettres allemandes. Franz Kafka et Milena Jesenska se sont rencontrés un an plus tôt à Vienne. Bien qu’aucune trace ne subsiste de cette première rencontre, tout porte à croire qu’elle fut assez forte pour créer entre l’écrivain et sa traductrice des liens que la mort n’effacera pas, mais que la vie ne suffira pas non plus à nouer complètement. Kafka, tuberculeux, s’éteindra quatre ans plus tard dans un sanatorium. Plus jeune et infiniment plus vigoureuse, Milena lui survivra pendant plus de vingt ans, avant de disparaître dans les camps nazis. Séparés par l’Histoire, mais plus encore par une insondable solitude, les deux amants ne se seront rencontrés, et véritablement aimés, que deux fois au cours de leur existence.
Le salut par l’écriture
Que penser de cette étrange relation épistolaire ? Les grands écrivains, c’est bien connu, sont rarement de grands amoureux. De Goethe à Rilke, de Miller à de Beauvoir, l’histoire abonde d’amours avortées et de liaisons contrariées, de passions plus promptes à s’épanouir sur la surface d’une page que dans l’épaisseur d’un lit, et que la moindre rencontre, la moindre confrontation avec l’autre, pulvérisent à jamais. De ce curieux paradoxe, Franz Kafka semble le champion toute catégorie. Lorsqu’il rencontre Milena Jesenska, l’écrivain de trente-six ans n’est pourtant pas ignorant des méandres de la vie amoureuse. Ses relations avec les femmes sont depuis toujours marquées par un mélange d’attrait et de répulsion, d’élan et de retenue, de confiance et d’instinctive méfiance. Bien qu’il ait été plusieurs fois amoureux, chacune de ses tentatives pour sceller une relation s’est soldée par un douloureux échec qui le confronte à la même aporie : une incapacité à rompre son isolement, à se laisser approcher par l’autre, un sentiment de culpabilité insurmontable : « le point commun à toutes mes histoires de fiançailles, c’est que tout a été de ma faute, indubitablement de ma faute, j’ai fait le malheur de mes deux fiancées » écrit-il à Milena. Pareille malédiction va-t-elle se reproduire avec elle ? Kafka ne serait pas Kafka si son destin n’était pas de se perdre en lui-même, de ne jamais trouver la sortie de son propre labyrinthe et de creuser inexorablement sa propre tombe. « Si je ne me sauve pas dans une œuvre, dira-t-il encore, je suis perdu. » Nul doute que la littérature lui offrira le salut que la vie ne lui aura pas accordé.
Une rencontre énigmatique
Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Dès les premières lettres de cette correspondance, l’auteur du Procès, séduit par la personnalité de la jeune traductrice, se montre un amant sincère et subtil, prêt à se livrer une fois encore aux tourments de l’amour, à s’affranchir de sa complaisante solitude, bref à surmonter sa crainte viscérale de la rencontre. Le vouvoiement est promptement abandonné, le ton se fait plus intime et plus pressant, les aveux plus cuisants, et pour le lecteur c’est tout l’intérêt de cette patiente mise à nu où se laisse voir l’une des âmes les plus lucides de ce siècle, à laquelle l’expression littéraire confère une vertigineuse complexité. Oui, Kafka joue bel et bien son va-tout dans cet amour. Bientôt, il ne sera plus seulement question de s’écrire et de s’attendre, mais de se voir et de se donner l’un à l’autre : à Prague, à Vienne, n’importe où. Franz y est pleinement résolu, Milena aussi. Reste à fixer le lieu, le jour et l’heure de la rencontre.
Mais c’est justement là où le bât blesse. En toute rencontre se joue le risque de l’amour, sa fragilité, son néant et son illusion ; mais aussi sa chance, sa beauté, sa force insondable. C’est précisément à ce double risque que Kafka n’est pas prêt, pas plus d’ailleurs que la lointaine Milena, entravée par ses propres démons et par le rempart d’un mariage décevant. Dès l’instant où le rendez-vous entre les deux amants est fixé, s’élève la muraille de Chine des terreurs ancestrales. A la veille de quitter Prague, l’écrivain se demande si tout cela est bien raisonnable, si le train arrivera à l’heure, s’il ne sera pas trop fatigué, si le douanier ne lui retirera pas son passeport… Tant d’atermoiements laissent le lecteur pantois, un rien amusé. Est-on dans un roman de Kafka ? Dans une page du Procès où le protagoniste, égaré dans le dédale du monde, voit ses entreprises sans cesse contrecarrées, confrontées à d’invisibles obstacles ? Non, nous sommes bien dans la réalité. C’est qu’à l’instant de passer à l’acte, Kafka redevient Kafka : l’homme de la peur, de l’empêchement, du renoncement. A ses yeux, rencontrer Milena, c’est s’éloigner de lui-même, consentir à son amour, c’est démentir sa souffrance, se lier à elle, c’est se délier de son ombre. Et surtout, c’est accéder au bonheur, cet or suprême dont l’avare ne connaît pas le prix.
Certes la rencontre aura bien lieu, bien brève en vérité, sorte de blanc biographique dans l’épaisseur des signes, mais des quelques heures que les deux amants auront passées ensemble la postérité ne saura pas grand-chose. Que s’est-il passé ce jour-là ? Que se sont-ils dit ? Se sont-ils rapprochés l’un de l’autre ? Quasiment rien n’est relaté de cet épisode, comme si la rencontre ne pouvait être évoquée, comme si seuls l’absence, le manque et la promesse appartenaient au registre de la parole. La correspondance se poursuit, les lettres s’échangent, moins ardentes qu’auparavant, mais le lien entre Franz Kafka et Milena Jesenska tourne désormais autour d’un centre vide, absent, inexprimable : l’échec de la rencontre.
De cet échec, leur relation ne se remettra pas. Pendant les années qui suivent, plus jamais Franz et Milena ne se retrouveront, plus jamais l’espoir d’un échange ne rapprochera ces deux solitaires que la vie continuera d’éloigner, dans la mort pour Kafka, dans la nostalgie pour Milena qui jusqu’à son terme entretiendra avec ferveur et clairvoyance le souvenir de son « Franz ». Que reste-t-il de cette rencontre qui n’a jamais eu lieu ? Eh bien, il reste la littérature. Lucide à défaut d’être libre, Kafka ne se méprend guère sur le pouvoir que lui confère son talent, son extraordinaire aptitude à exprimer par le verbe l’impasse d’une existence : « Tout le malheur de ma vie (…) vient, si l’on veut, des lettres ou de la possibilité d’en écrire. La vraie raison, c’est l’impuissance qui va s’accentuant dans nos lettres, de sortir de ces lettres mêmes, pour toi aussi bien que pour moi. »
Si l’homme est vaincu, l’écrivain demeure
Tout est dit dans ces quelques mots. Cherchant dans la littérature un salut que l’existence lui aura refusé, l’auteur du Verdict observe avec amertume combien cette dernière ne cesse de se dérober à son pouvoir, augmente son impuissance et sa défaite au lien de l’en délivrer. La défaite est-elle totale ? Si l’homme est vaincu, l’écrivain demeure. Avant de mourir, Kafka laissera une poignée de romans où se lit de manière exemplaire le destin de l’homme moderne : le Procès, le Château, l’Amérique, la Métamorphose. Quant à Milena Jesenska, ayant choisi la vie plus encore que la littérature, elle poursuivra une existence où la passion semble occuper une place qui n’aura pas été dévolue à son éphémère amant. Si la postérité ne retiendra guère son nom, elle demeure néanmoins la grande absente de cette poignante correspondance. Les quelques lettres adressées à Max Brod, ses articles de journaux, témoignent que, autant qu’un écrivain de talent, elle fut une vivante exceptionnelle.






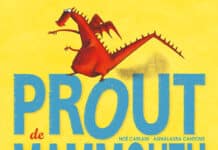









![[Manga] Oldman – Tome 01, de Chang Sheng (Glénat Manga)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344071731-001-x-100x70.webp)


![[BD] La Grande Histoire de Picsou – Tome 02, de Don Rosa (Glénat – Disney / Les Grands Maîtres)](https://publikart.net/wp-content/uploads/2026/02/9782344074091-001-x-100x70.webp)