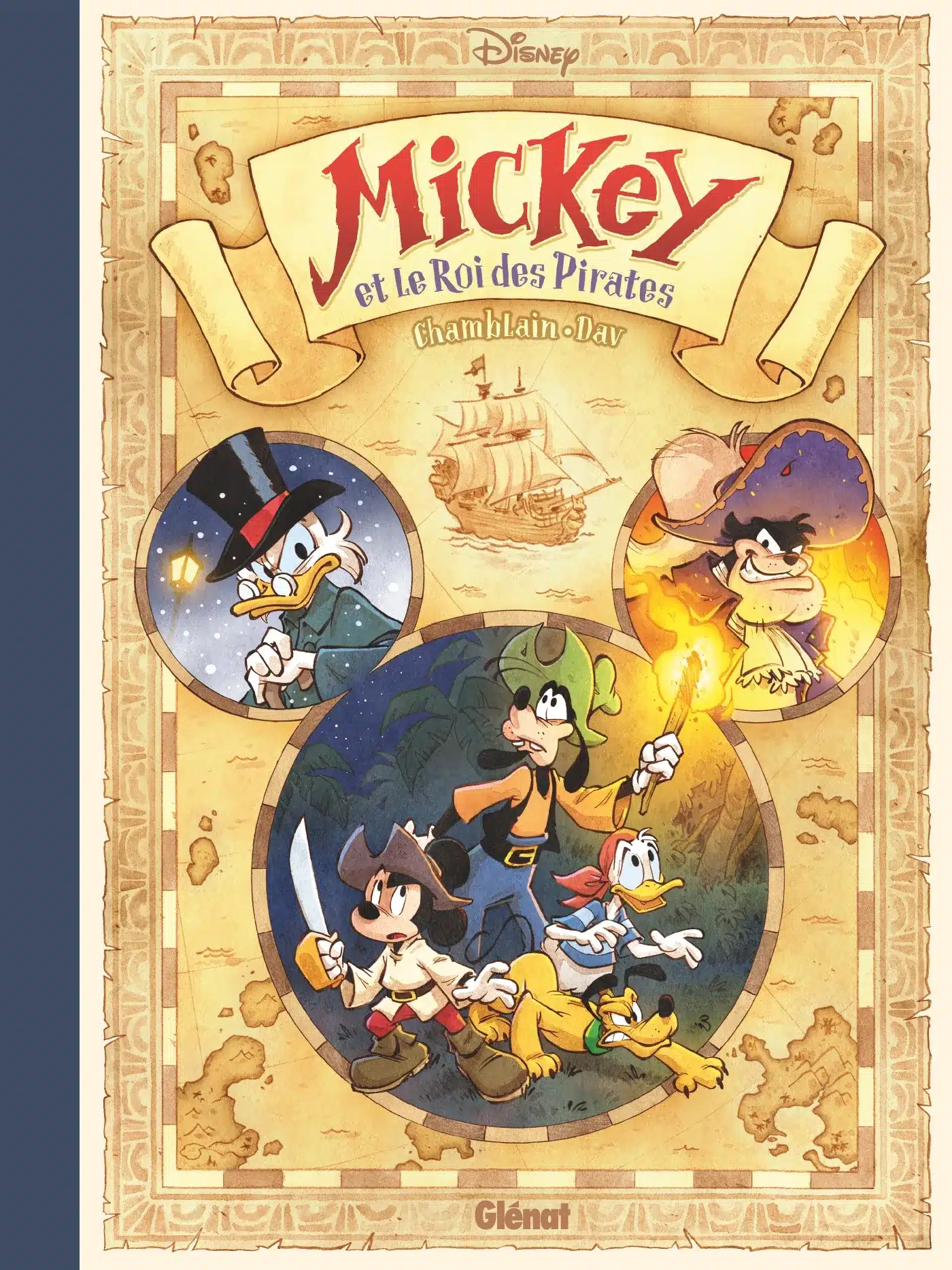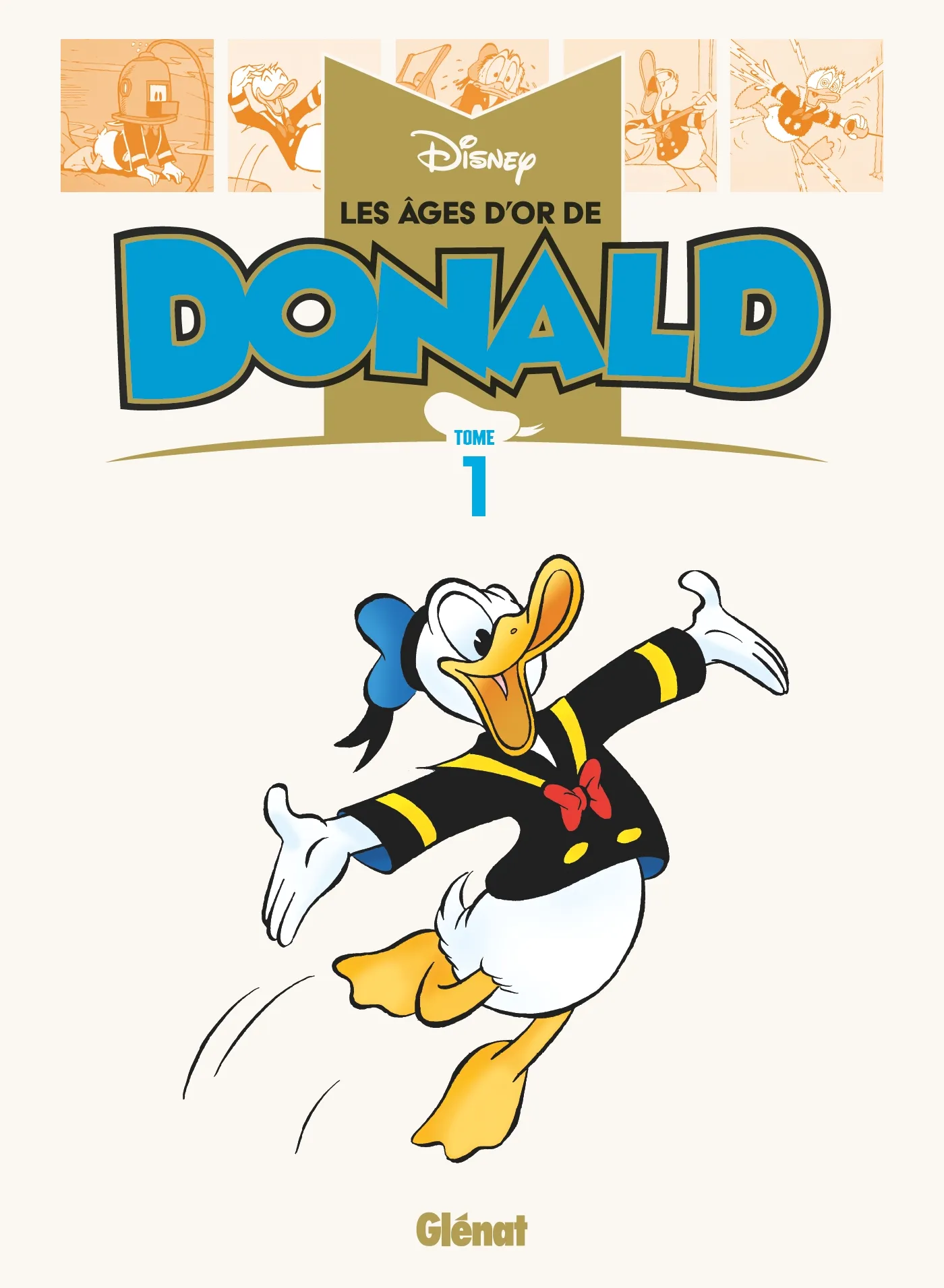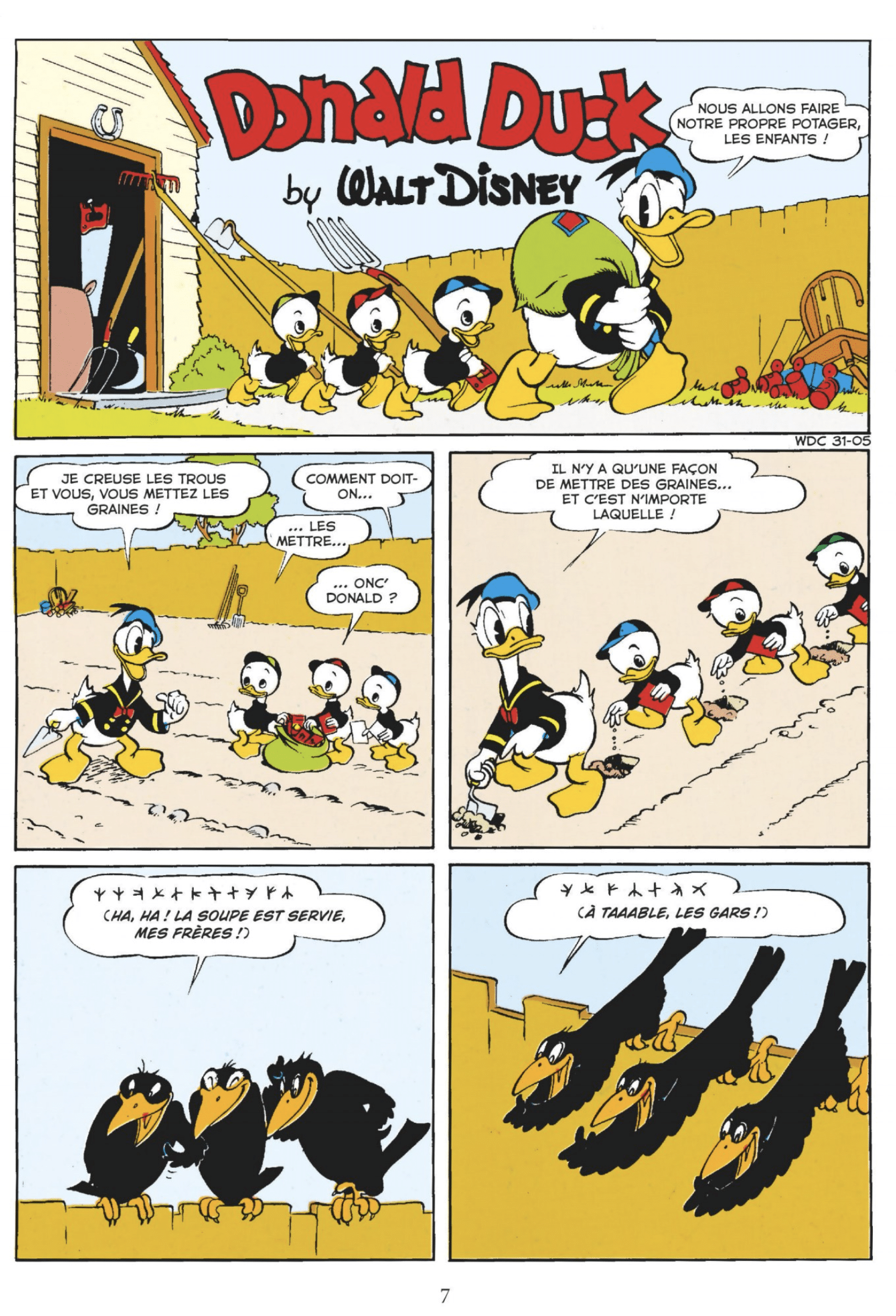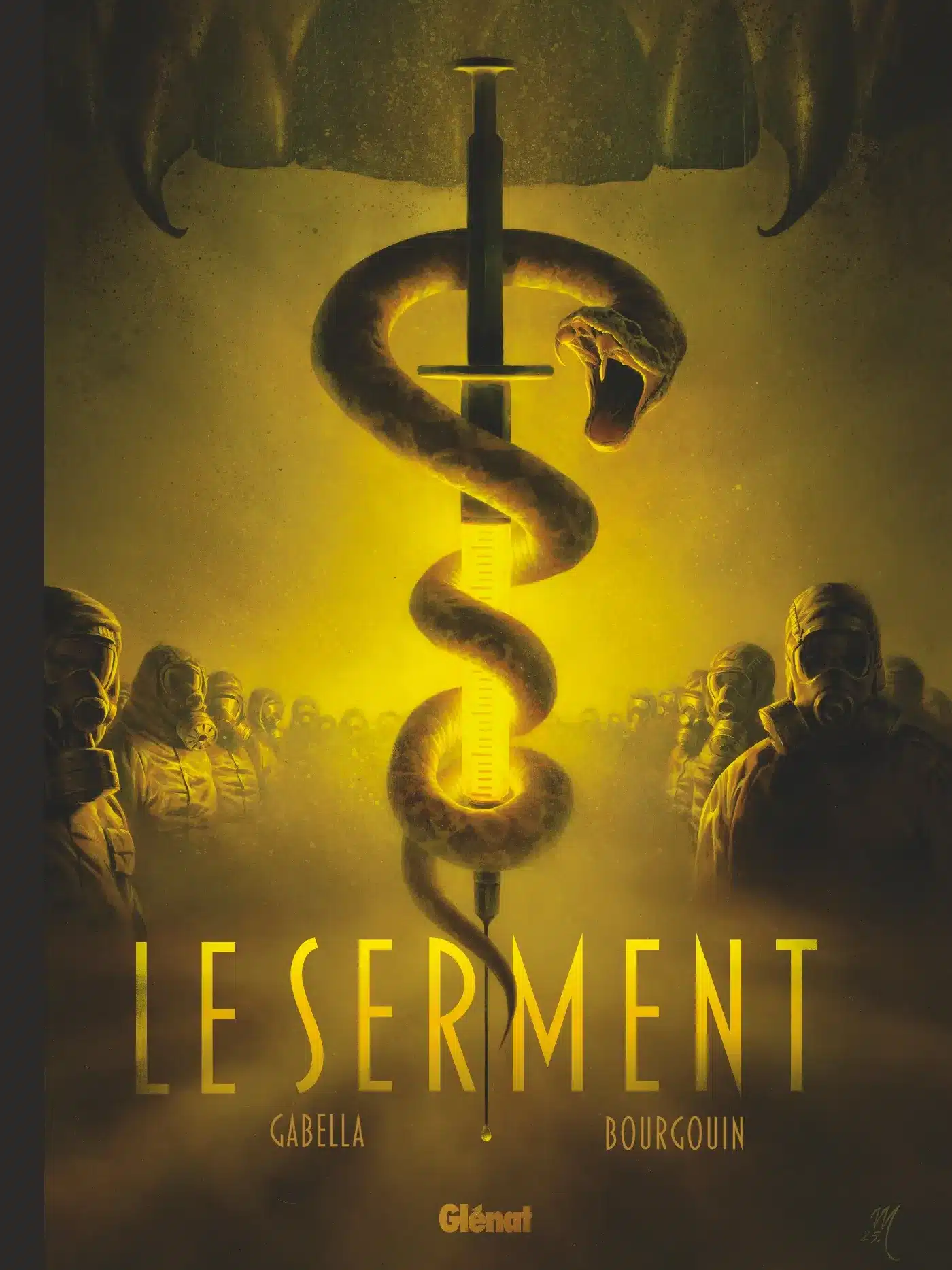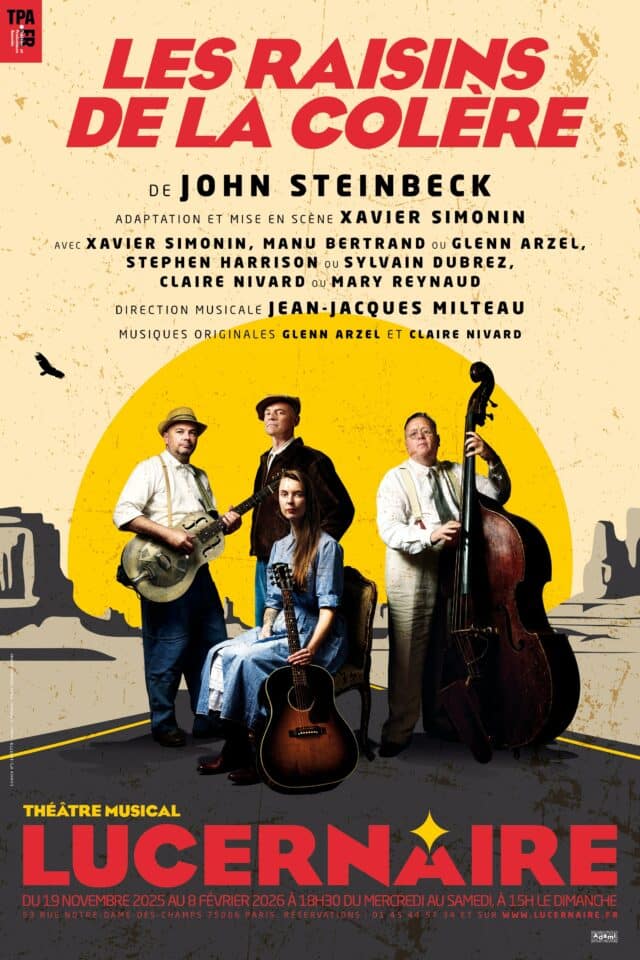Les Simpson n’arrêtent pas de marquer les différentes générations de téléspectateurs depuis 1989. Les plus anciens ont connu les premières saisons, d’autres ont pris le train en marche, d’autres encore sont montés dans le train avec le film de 2007. Romain Nigita offre un tour d’horizon complet et impressionnant dans cet ouvrage sorti aux éditions Playlist Society. Je me suis demandé si il n’a pas revu tous les épisodes plusieurs fois pour amasser autant d’anecdotes et de détails aussi précis qu’évocateurs. Tous les personnages, toutes les époques, toutes les influences extérieures et de nombreuses intrigues sont passées en revue avec gourmandise et sagacité dans un ouvrage petit et ramassé mais surtout d’une densité folle pour qui a grandi en même temps que Marge et Homer. La lecture offre de belles analyses et surtout de beaux flashbacks sur ses propres souvenirs personnels de visionnages marqués au fer rouge dans l’esprit. Le livre permet de comprendre pourquoi la série a connu une si longue existence, prévue à aujourd’hui jusqu’en 2029, au moins. A suivre…
Synopsis: Apparue sur le petit écran en 1989, Les Simpson va bientôt franchir le seuil des 40 saisons. Un record dans l’histoire des séries télé, qui s’accompagne d’une résonance culturelle inédite. Les personnages ont beau ne pas vieillir, Les Simpson ne cesse de décrypter l’évolution de la société américaine, sans que les anciens épisodes perdent en pertinence au fil des rediffusions. Une approche qui crée un paradoxe surprenant : la série ne change jamais, tout en étant en constante mutation.
Les Simpson ou le paradoxe du donut intemporel s’appuie sur les explications exclusives du showrunner Al Jean pour explorer toutes les facettes d’une œuvre qui ne laisse aucun sujet de côté, de la politique à l’économie, de l’environnement à la santé, de la religion à la société de consommation.
Préface signée par Véronique Augereau et Philippe Peythieu, les voix françaises de Marge et Homer Simpson.
Romain Nigita est journaliste et critique de séries télé pour différents médias (France Inter, Le JDD, Mad Movies, et aujourd’hui Télé Star). Il est également le co-auteur avec Alain Carrazé de Séries’ Anatomy : le 8e art décrypté (éditions Fantask, 2017).
Editeur: Playlist Society
Auteur: Romain Nigita
Nombre de pages / Prix: 176 pages / 17 euros









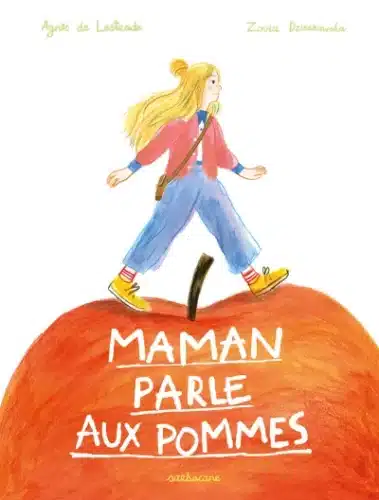







 [BD] Tunnels – virée infernale sur route sans issue (Glénat)
[BD] Tunnels – virée infernale sur route sans issue (Glénat)